Qu’est-ce que "l’ADN de parentèle", qui a permis d'identifier le "prédateur des bois" 20 ans plus tard?
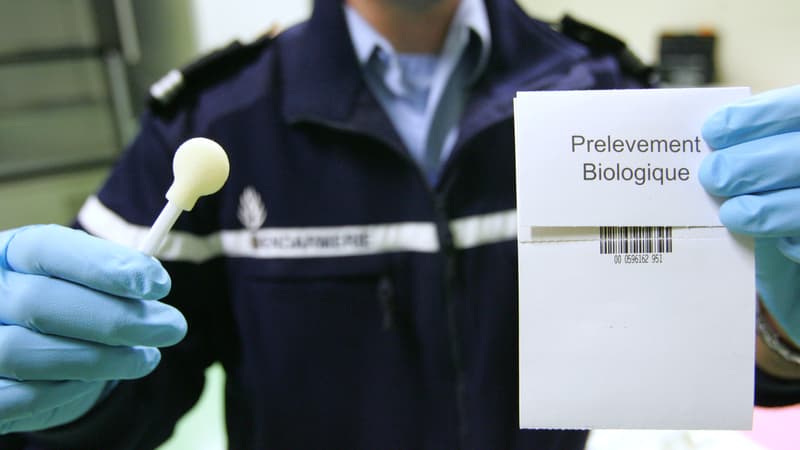
(Photo d'illustration) - Mehdi Fedouach - AFP
C’est la fin d’une enquête vieille de 20 ans qui se profile. Jeudi dernier, les enquêteurs de la police judiciaire ont mis la main sur un individu recherché depuis longtemps: un homme soupçonné de cinq viols entre 1998 et 2008 qu’ils avaient surnommé le "prédateur des bois" en raison de son mode opératoire, ce dernier enlevant ses victimes et les emmenant dans des zones boisées afin de les violer.
Jusque-là, les investigations ne pouvaient s’appuyer que sur des portraits-robots réalisés à partir des témoignages des victimes. De lui, on ne connaissait que son “regard acier”, son visage émacié et ses cheveux grisonnants.
Car s’il laissait son ADN sur la scène de crime à chaque nouveau viol, les enquêteurs n’ont jamais pu mettre un nom sur le suspect: celui-ci n’était pas inscrit au Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), qui permet de recenser les profils génétiques des auteurs d’infractions.
Comparer les profils génétiques
C’est pourtant bien grâce à son empreinte génétique que les forces de l’ordre sont parvenues à leurs fins. Pour retrouver le "prédateur des bois", ils ont utilisé l’ADN de parentèle, une technique récente permettant de remonter à des membres de la même famille à partir de l’empreinte génétique.
"On va interroger le FNAEG et en comparant le profil génétique inconnu, celui de l’auteur des faits a priori, en abaissant les critères de match de façon à ce que quelqu’un ayant une parenté au premier degré, en descendance ou ascendance directe, matche", détaille Marie-Gaëlle Le Pajolec, directrice de l'Institut Génétique Nantes Atlantique, contactée par RMC Crime.
Pour que la recherche de parentèle fonctionne, il faut donc respecter plusieurs critères bien précis: que l'auteur présumé des faits ait laissé de l'ADN sur la scène de crime, que toutes les autres voies d'enquête aient été explorées sans aboutir, et que l'un des membres de la famille de l'individu recherché ait déjà commis une infraction et soit donc enregistré au FNAEG.
Si une correspondance est trouvée, les enquêteurs peuvent ensuite poursuivre leurs recherches en effectuant des prélèvements dans la famille identifiée.
L'ADN de parentèle, clé de l'affaire Kulik
Selon Marie-Gaëlle Le Pajolec, si le principe utilisé pour trouver l'identité du "prédateur des bois" est bien celui de l'ADN de parentèle, il ne repose cette fois-ci pas sur le FNAEG: dans ce cas précis, les enquêteurs se sont appuyés sur des bases de données internationales et ont travaillé en collaboration avec le FBI sur les analyses génétiques.
"Le lien de parenté recherché peut ainsi être beaucoup plus éloigné car ce ne sont pas les mêmes séquences que l’on analyse", explique Marie-Gaëlle Le Pajolec.
Cette technique existait déjà à l'étranger mais elle a fait son entrée il y a seulement quelques années au sein de la police scientifique française, permettant de résoudre l'affaire Elodie Kulik. En 2012, les enquêteurs remontent à l'un des agresseurs dont le père était inscrit au FNAEG. Un an plus tard, William Bardon et les autres agresseurs ont ainsi été arrêtés pour le viol et le meurtre, en 2002, de la directrice d'agence bancaire de la Somme.
Il y a quelques années, cette technique avait notamment permis de poser, enfin, un nom sur celle que l’on surnommait la "petite martyre de l’A10", une fillette abandonnée le long d’une autoroute dont les parents devraient bientôt être jugés.
En garde à vue, l’homme surnommé "le prédateur des bois" a finalement reconnu les faits qui lui sont reprochés en région parisienne. Il nie cependant le viol d’une jeune fille en Charente-Maritime, en 1998.


